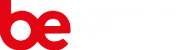Le vice-président américain J.D. Vance a récemment accordé une interview à un média britannique dans laquelle il s’interroge sur la relation sécuritaire entre les États-Unis et l’Europe. Selon lui, il n’est pas sain que les Européens restent dépendants de Washington pour leur défense. Ce positionnement, inhabituel dans la bouche d’un haut responsable américain, marque une rupture de ton qui n’a pas manqué de faire réagir.
Dans son intervention, J.D. Vance estime que la plupart des pays européens ne disposent pas aujourd’hui de forces armées capables de défendre raisonnablement leur territoire. Il accuse les gouvernements concernés d’avoir sous-investi dans la défense, profitant de la présence militaire américaine depuis la Seconde Guerre mondiale. Il exempte toutefois la France et le Royaume-Uni de ce constat.
Ce type de propos n’est pas nouveau dans les milieux diplomatiques : plusieurs personnalités, comme l’ancien ministre français Hubert Védrine, soulignent depuis longtemps que la relation transatlantique n’est pas fondée sur une égalité stratégique. Les États-Unis agissent comme puissance protectrice, et les Européens ont souvent fait le choix de cette dépendance, notamment dans le contexte de la guerre froide.
Ces déclarations trouvent un écho particulier dans les pays d’Europe de l’Est, traditionnellement attachés à la garantie sécuritaire américaine. En Pologne ou dans les pays baltes, on observe un début d’évolution dans les discours politiques. L’idée d’une plus grande autonomie stratégique, longtemps perçue comme une approche française isolée, commence à être considérée avec davantage de sérieux.
Ce changement d’état d’esprit ne remet pas en cause les relations commerciales et militaires avec les États-Unis, mais il traduit une forme de lucidité face à la possibilité d’un désengagement américain.
Une référence inattendue à Charles de Gaulle
Dans le même entretien, Vance évoque Charles de Gaulle de manière élogieuse. Il souligne que le général avait su défendre l’indépendance stratégique de la France tout en entretenant une relation avec les États-Unis. Une prise de position surprenante, quand on sait à quel point la politique de désengagement partiel de la France vis-à-vis de l’OTAN avait été critiquée à l’époque par Washington.
Ce rappel historique permet à Vance de soutenir l’idée qu’une Europe plus autonome n’est pas contraire aux intérêts américains. Il insiste sur le fait que la dépendance actuelle ne sert ni l’Europe, ni les États-Unis.
Au-delà de la question européenne, certains proches de Donald Trump évoquent la possibilité d’un rapprochement stratégique entre les États-Unis et la Russie. L’idée serait d’affaiblir le lien entre Moscou et Pékin, dans une logique inspirée de la politique menée par Henry Kissinger dans les années 1970 avec la Chine.
À cela s’ajoutent des intérêts économiques : certaines personnalités américaines évoquent déjà des opportunités commerciales en Russie, notamment dans le secteur des matières premières. Ce discours rappelle d’autres périodes de l’histoire où les considérations géopolitiques et commerciales ont pesé plus lourd que les principes démocratiques dans la diplomatie américaine.