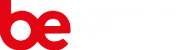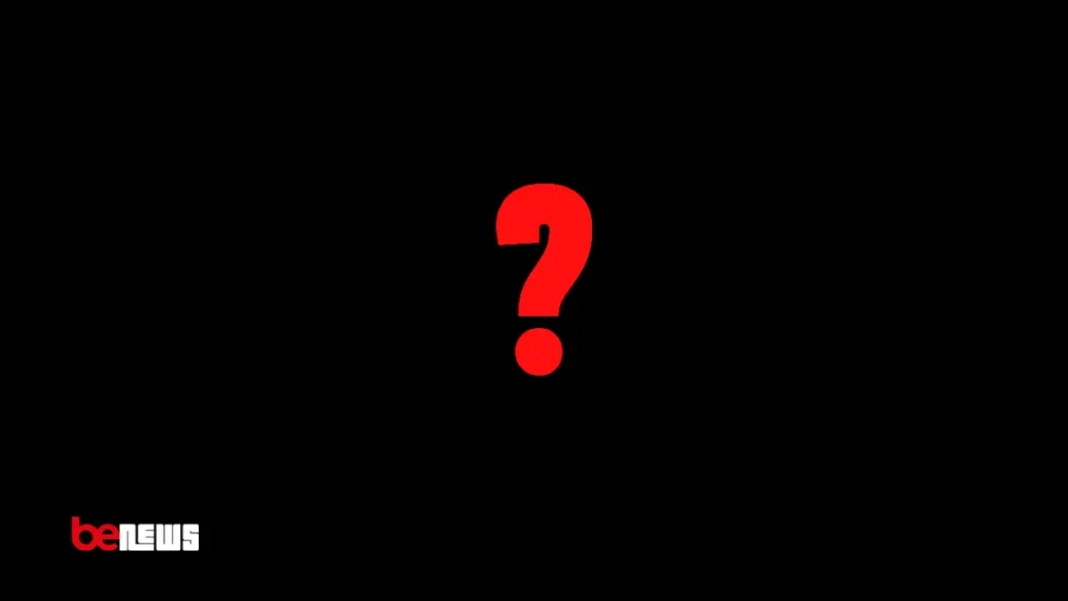Sous le vernis d’un modèle social souvent envié, la réalité du travail en France révèle des disparités criantes. Derrière les statistiques sur les 35 heures ou les congés payés, des millions de Français peinent à joindre les deux bouts, multiplient les emplois ou travaillent au noir pour compenser des revenus insuffisants. À travers une série de portraits et d’enquêtes diffusés sur France 2, le contraste est saisissant.
Coralie Marchand, accompagnante d’élèves en situation de handicap, cumule trois autres activités : garde d’enfants, comptabilité, et cours de danse. Son salaire principal – 1 000 euros nets pour 24 heures par semaine – ne lui permet pas de couvrir l’ensemble de ses charges mensuelles, estimées à 1 200 euros. Grâce à ses emplois secondaires, elle atteint 1 500 euros, mais reste à la merci du moindre imprévu. « Je travaille, je paie mes factures, et je ne fais rien d’autre », confie-t-elle, la voix serrée.
Philippe Bourdeaux vit une autre forme de double vie. Employé comme moniteur d’auto-école à temps plein, il enchaîne chaque soir avec son second métier, agriculteur. Il cultive ses terres la nuit, entre deux récoltes et semis, parfois jusqu’à 4h du matin. Ce mode de vie éreintant lui permet de financer les charges de sa ferme et d’anticiper une retraite qu’il estime à 700 euros par mois. « Si je pouvais ne vivre que de mon exploitation, je le ferais sans hésiter », affirme-t-il. Mais pour l’instant, c’est l’équilibre fragile d’une passion et d’une nécessité.
Ils sont aujourd’hui plus de deux millions en France à cumuler plusieurs activités. Une réponse à la stagnation des salaires, à la hausse du coût de la vie, ou à des pensions de retraite jugées insuffisantes.
Et pourtant, la France conserve l’image d’un pays qui travaille peu. Avec 1 673 heures travaillées par an pour un salarié à temps complet, elle se situe parmi les derniers en Europe sur ce critère, loin derrière l’Allemagne (1 790 heures). Cette moyenne cache cependant une autre réalité : celle d’un marché du travail peu inclusif. Le taux d’emploi, à 68 %, est plombé par une démographie particulière – davantage d’enfants et de retraités que dans la plupart des pays européens – et un taux d’activité plus faible.
Autre ombre au tableau : la baisse de la productivité. Depuis le début des années 2000, et surtout depuis la crise du Covid, la richesse créée par heure travaillée recule. Les carnets de commandes s’amenuisent, les coûts de production augmentent, et les investissements ralentissent, affectant directement la compétitivité des entreprises françaises.
Pourtant, dans certains secteurs, les entreprises rivalisent d’imagination pour attirer ou retenir leurs salariés. Véhicules de fonction haut de gamme, salles de sport en entreprise, ostéopathie, salles de jeux ou encore cagnottes de 500 euros à dépenser librement : ces avantages fleurissent dans les grandes entreprises, mais restent inaccessibles à la majorité. Moins de 1 % des salariés français bénéficient, par exemple, d’une conciergerie sur leur lieu de travail.
À l’autre bout de la chaîne, certains cumulent les emplois dans l’illégalité. En Italie, pays voisin, une enquête a révélé que 20 % de l’activité économique se fait au noir. Sur les chantiers napolitains, un ouvrier sur deux n’est pas déclaré. Pour certains, le travail au noir est un complément nécessaire à des allocations insuffisantes. Pour d’autres, comme cette étudiante employée sous un faux intitulé de poste et pour des horaires doublés, c’est une exploitation déguisée. Le gouvernement italien multiplie les inspections, sous pression de l’Union européenne qui conditionne une partie du plan de relance à la lutte contre la fraude sociale.