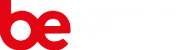Un bras de fer inédit oppose la prestigieuse université de Harvard à l’administration Trump. En cause : le refus de l’établissement de se soumettre aux exigences du gouvernement fédéral. Résultat immédiat, le 14 avril, la Maison-Blanche annonçait le gel de 2,2 milliards de dollars de subventions fédérales destinées à l’université. Un épisode qui cristallise les tensions entre pouvoir exécutif et institutions académiques dans un climat politique américain de plus en plus polarisé.
Tout part d’une lettre adressée par le cabinet d’avocats représentant Harvard à trois hauts responsables de l’administration Trump. Dans cette missive, l’université rejette catégoriquement les demandes de Washington, parmi lesquelles la fermeture immédiate des programmes de diversité, équité et inclusion (DEI), la transmission de toutes les données d’admission et de recrutement au gouvernement, ainsi qu’un audit complet des opinions exprimées par les étudiants et le personnel enseignant.
Alan Garber, président de Harvard, a réaffirmé dans une déclaration publique l’indépendance de l’université :
« Aucun gouvernement, quel que soit le parti au pouvoir, ne devrait dicter ce que les universités peuvent enseigner, qui elles peuvent admettre ou embaucher, ni quels domaines de recherche elles doivent poursuivre. »
L’antisémitisme : un motif officiel, mais controversé
L’administration Trump justifie sa décision en invoquant la montée de l’antisémitisme sur les campus. À l’automne 2023, Harvard a été le théâtre de manifestations pro-palestiniennes après les événements du 7 octobre, certaines ayant donné lieu à des propos ou actes jugés antisémites. Ces dérives ont suscité des plaintes d’étudiants et ont conduit en janvier 2024 à la démission de la présidente Claudine Gay, accusée de minimiser les incidents.
Malgré les mesures prises par l’université depuis pour renforcer ses dispositifs de prévention contre les discriminations, le gouvernement juge les réponses insuffisantes. Le gel des fonds s’inscrit dans le cadre de l’action d’une task force fédérale de lutte contre l’antisémitisme.
Au-delà de la lutte contre l’antisémitisme, plusieurs observateurs estiment que ce bras de fer cache une offensive politique contre les bastions du progressisme universitaire. Harvard, comme d’autres institutions de la côte Est, incarne aux yeux de Donald Trump et de ses partisans la « culture woke » qu’ils dénoncent avec vigueur.
Le ministère de l’Éducation a d’ailleurs élargi ses critiques en mars, évoquant aussi la promotion d’idéologies clivantes, perçues comme une entrave à la liberté académique. Cette offensive s’inscrit dans une stratégie plus large : remettre en cause les politiques de discrimination positive et restreindre les financements publics jugés inutiles.
Une résistance symbolique et risquée
Face à cette attaque, Harvard ne plie pas. Plus de 800 membres de son corps enseignant ont signé une lettre de soutien à la direction, appelant à une réponse ferme et coordonnée face à ce qu’ils qualifient de « dérive antidémocratique ».
L’université bénéficie d’un avantage de taille : sa richesse. Les subventions fédérales ne représentent qu’environ 11 % de son budget. Elle avait d’ailleurs anticipé le bras de fer en levant récemment 750 millions de dollars sur les marchés. Mais le risque est ailleurs : dans la réaction de ses donateurs privés. Plusieurs d’entre eux avaient déjà exprimé leur malaise face aux controverses passées, et pourraient se retirer sous la pression politique.
Il faut noter que Harvard pourrait ne pas être la seule cible. Columbia, autre grande université américaine, a préféré céder face aux exigences fédérales. Mais la décision de Harvard d’entrer en résistance pourrait faire école. Certains y voient même le début d’un mouvement de contestation plus large au sein des institutions académiques américaines.