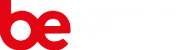Le 3 avril 2025, le président Patrice Talon a promulgué une loi historique consacrant un cadre juridique à la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Adoptée par l’Assemblée nationale quelques semaines plus tôt, cette loi n°2025-09 reconnaît officiellement l’existence et le rôle des structures coutumières, tout en les intégrant dans un dispositif républicain sans les assimiler à une administration publique.
Le texte définit la chefferie traditionnelle comme une organisation socioculturelle précoloniale dont les détenteurs d’autorité sont les garants des us et coutumes. Trois catégories sont formellement reconnues : les royaumes, les chefferies supérieures et les chefferies coutumières. Une quarantaine de royaumes et de chefferies ont été listés dans la loi, de Allada à Nikki en passant par Dogbo-Ahomey, Adjara ou encore les Batammariba. Chaque entité dispose d’un mode de gouvernance propre, incarné par un roi, un chef supérieur ou un chef coutumier.
La loi précise que ces autorités traditionnelles ne relèvent pas de l’administration publique mais peuvent accompagner l’État dans la mise en œuvre de politiques d’éducation, de cohésion sociale, ou de sauvegarde du patrimoine culturel. Leur rôle s’étend à la médiation sociale, à la promotion des langues locales, et à la préservation des rites, contes et coutumes.
Pour garantir la légitimité des détenteurs de pouvoir traditionnel, la loi encadre strictement les conditions d’accès au trône. Chaque royaume ou chefferie dispose d’un conseil de désignation, chargé de conduire le processus de sélection selon les règles héritées de la tradition, en tenant compte de critères comme l’appartenance lignagère, l’intégrité morale, ou encore la validation par l’oracle. L’installation des nouveaux chefs est constatée par arrêté ministériel conjoint, ce qui vaut reconnaissance officielle.
Les chefs sont tenus à un devoir de neutralité, d’impartialité et de loyauté envers la République. Ils doivent s’abstenir de toute activité politique partisane, sous peine de sanctions allant de l’avertissement à la suspension, voire au retrait de l’acte de reconnaissance. Toute infraction aux lois ou comportement portant atteinte à la paix sociale peut également entraîner leur mise à l’écart.
La loi confère aussi un certain nombre d’avantages symboliques ou matériels. Les rois et chefs sont invités aux cérémonies officielles, peuvent être décorés, consultés sur des questions sensibles et bénéficier d’un appui logistique, voire d’une allocation, selon des modalités fixées par voie réglementaire. Ils siègent à vie à la chambre nationale de la chefferie traditionnelle, instance représentative dont les contours seront définis par décret.
Intégralité de la loi N° 2025-09 DU 03 AVRIL 2025
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE PREMIER
DÉFINITIONS – OBJET – CHAMP D’APPLICATION
Article 1er : Au sens de la présente loi, les termes ci-après se définissent comme suit :
- abdication : renonciation à la fonction de roi, de chef supérieur ou de chef coutumier ;
- chefferie traditionnelle : forme d’organisation sociale et culturelle ayant pris ses origines dans la période précoloniale dans l’un des espaces de l’actuelle République du Bénin dont les autorités sont gardiennes des us et coutumes admis en République du Bénin ;
- conseil de désignation : instance qui reçoit et examine les candidatures à la fonction de roi, de chef supérieur et de chef coutumier. Elle organise et gère le processus de désignation des rois, des chefs supérieurs et des chefs coutumiers ;
- culture : ensemble des connaissances, des croyances, des expressions artistiques, des règles d’éthique et de morale, des règles et usages coutumiers, et des autres capacités ou habitudes qui caractérisent un groupe, une communauté humaine et qui sont véhiculées par une langue commune ;
- interrègne : période transitoire dans la gestion d’une chefferie traditionnelle séparant deux règnes. Elle intervient à la suite du décès du roi, du chef supérieur ou du chef coutumier conformément aux règles coutumières ;
- royaume : entité socioculturelle à pouvoir centralisé ayant pris naissance dans la période précoloniale, regroupant des communautés socioculturelles diverses et disposant d’une cour royale, placée sous l’autorité d’un roi ou d’une reine ;
- us et coutumes : habitudes et pratiques identitaires spécifiques à un groupe socioculturel et qui garantissent le respect des lois de la République, de la dignité et le développement de la personne humaine, le droit à la vie, à la santé et au progrès social.
CHAPITRE II
OBJET – CHAMP D’APPLICATION
Article 2 : La présente loi fixe les règles relatives au régime juridique de la chefferie traditionnelle et les conditions et modalités d’exercice de son rôle de gardien des us et coutumes en République du Bénin.
Article 3 : La présente loi s’applique :
- à l’espace de compétence de la chefferie traditionnelle ;
- à la dévolution du pouvoir traditionnel ;
- à la reconnaissance de la chefferie traditionnelle ;
- aux attributions, droits et devoirs de la chefferie traditionnelle.
TITRE II
COMPOSITION – ATTRIBUTIONS DE LA CHEFFERIE TRADITIONNELLE
CHAPITRE PREMIER
COMPOSITION DE LA CHEFFERIE TRADITIONNELLE
Article 4 : La chefferie traditionnelle regroupe les entités sociales et culturelles à pouvoir traditionnel centralisé appelées royaumes, les entités sociales et culturelles caractérisées par un pouvoir traditionnel moyennement centralisé appelées chefferies supérieures et les entités sociales caractérisées par un pouvoir non centralisé et indépendant appelées chefferies coutumières.
Article 5 : Sont reconnues comme royaumes en République du Bénin, les chefferies traditionnelles ci-après :
- le royaume d’Allada ;
- le royaume de Bassila ;
- le royaume de Bouè ;
- le royaume du Danhomè ;
- le royaume de Dogbo-Ahomey ;
- le royaume de Hogbonou ;
- le royaume de Igbo-Idaasha ou Dassa-Zounmè ;
- le royaume de Itakété ou Sakété ;
- le royaume de Kétou ;
- le royaume de Kika ;
- le royaume de Kilir ou Djougou ;
- le royaume de Kpanné ou Kouandé ;
- le royaume de Nikki ;
- le royaume de Sandiro ;
- le royaume de Savalou ;
- le royaume de Tchabè ou Savè.
Dans chacun des royaumes, l’autorité traditionnelle est assurée par un roi.
Article 6 : Sont reconnues comme chefferies supérieures dépendantes ou non, à pouvoir moyennement centralisé, les chefferies traditionnelles ci-après :
- la chefferie des Watchi de Comè ;
- la chefferie des Saxwè de Doutou dans Houéyogbé ;
- la chefferie des Idjè ;
- la chefferie des Kotafon de Lokossa ;
- la chefferie de Dangbo ;
- la chefferie de Kpanwignan ;
- la chefferie de Soclogbo ;
- la chefferie de Gbaffo ;
- la chefferie de Dovi-Somè ;
- la chefferie d’Agouagon ;
- la chefferie de Gbowèlè ;
- la chefferie de Tchahounkou ;
- la chefferie de Thio ;
- la chefferie de Ouèdèmè dans Glazoué ;
- la chefferie de Assanté ;
- la chefferie de Don ;
- la chefferie de Gounli ;
- la chefferie de Doga ;
- la chefferie d’Agonvè ;
- la chefferie de Kpankou ;
- la chefferie de Zagnanado ;
- la chefferie d’Agonlin-Houégbo ;
- la chefferie de Tori-Bossito ;
- la chefferie d’Adjara ;
- la chefferie de Kétonou ;
- la chefferie d’Ekpè ;
- la chefferie d’Avrankou ;
- la chefferie de Koutago ;
- la chefferie de Logozohè ;
- la chefferie de Monkpa ;
- la chefferie de Doïssa ;
- la chefferie d’Aklamkpa ;
- la chefferie de Ouèssè ;
- la chefferie de Mondji ;
- la chefferie Hwlagan dans Grand-Popo ;
- la chefferie d’Agoué ;
- la chefferie de Hlasssamè ;
- la chefferie d’Azovè ;
- la chefferie d’Aplahoué ;
- la chefferie de Lalo ;
- la chefferie d’Adjahonmey ;
- la chefferie de Djakotomey ;
- la chefferie des Mokollé ;
- la chefferie de Manigri ;
- la chefferie d’Igbèrè ;
- la chefferie de Wannou ;
- la chefferie de Kikélé ;
- la chefferie de Igbomakro ;
- la chefferie de Doguè ;
- la chefferie de Bantè ;
- la chefferie d’Adja-Ouèrè ;
- la chefferie de Parakou ;
- la chefferie de Kandi ;
- la chefferie de Darou ;
- la chefferie de Kpara ;
- la chefferie de Pèrèrè ;
- la chefferie de Kalalé ;
- la chefferie de Basso ;
- la chefferie de Gbassi ;
- la chefferie de Sinendé ;
- la chefferie de Saoré ;
- la chefferie de Bembèrèkè ;
- la chefferie de Sougou Pantrosi ;
- la chefferie de Bouanri ;
- la chefferie de Guéra N’kali ;
- la chefferie de Sékéré ;
- la chefferie de Tchaourou ;
- la chefferie de Mora Wonkourou ;
- la chefferie de Tannou ;
- la chefferie de Kabo ;
- la chefferie de Waria ;
- la chefferie de Kokobe ;
- la chefferie de Kpané ;
- la chefferie de Yinsi ;
- la chefferie de Diguidirou ;
- la chefferie de Guina Gourou ;
- la chefferie de Birni ;
- la chefferie de Kérou ;
- la chefferie de Wassa-Tobré ;
- la chefferie de Karimama ;
- la chefferie de Guéné.
Dans chaque chefferie supérieure, l’autorité traditionnelle est assurée par un chef supérieur.
Article 7 : Sont reconnues comme chefferies coutumières à pouvoir non centralisé, les chefferies traditionnelles ci-après :
- la chefferie des Batammariba ;
- la chefferie des Bialbè ;
- la chefferie des Foods ;
- la chefferie des Gulmancèba ;
- la chefferie des Lokpa ;
- la chefferie des Mbelmè ;
- la chefferie des Natemba ;
- la chefferie des Yowa ;
- la chefferie des Tem ;
- la chefferie des Waaba.
Dans chaque chefferie coutumière, l’autorité traditionnelle est assurée par un chef coutumier.
Article 8 : Toute personne qui représente l’autorité traditionnelle au sein des formes d’organisation sociales traditionnelles non répertoriées dans les articles 5, 6 et 7 de la présente loi est dénommée chef communautaire.
CHAPITRE II
ATTRIBUTIONS DE LA CHEFFERIE TRADITIONNELLE – RELATIONS ENTRE ROIS ET CHEFS SUPÉRIEURS
Article 9 : La chefferie traditionnelle est garante des us et coutumes qui sont positifs. Elle assiste et collabore avec l’État dans la mise en œuvre de sa politique de l’éducation et de la cohésion sociales. À ce titre, elle est chargée notamment de :
- contribuer à la promotion et à la valorisation des us et coutumes positifs ;
- contribuer à reconstituer et à faire connaître l’histoire de la communauté ;
- contribuer à la sauvegarde du patrimoine culturel matériel et immatériel de son espace ;
- contribuer à répertorier et conserver les rites de la communauté ainsi que son histoire ;
- contribuer à la promotion des langues locales béninoises en usage dans son espace à travers notamment les contes et légendes, les chants et danses, les proverbes et l’alphabétisation ;
- veiller à la tenue régulière des cérémonies et organisations festives communautaires ;
- promouvoir le vivre-ensemble, la paix et la cohésion sociales à l’intérieur de la communauté et avec les autres communautés ;
- assurer la médiation sociale dans le règlement des conflits en matières coutumières ;
- veiller à la moralisation de la vie en communauté ;
- contribuer à la vulgarisation des textes de la République ;
- collaborer avec les pouvoirs publics pour la sécurité et le bien-être des populations vivant sur son espace.
Article 10 : Les attributions prévues à l’article 9 de la présente loi ne font pas de la chefferie traditionnelle une structure administrative ni un prestataire de service de l’État.
Article 11 : Les relations qui existent entre les rois et les chefs supérieurs se présentent ainsi qu’il suit :
- les rois et les chefs supérieurs qui partagent un même espace socioculturel se doivent mutuellement respect, collaboration et assistance pour maintenir la paix et la cohésion sociale au sein de la communauté ;
- les rois partageant le même espace socioculturel avec des chefs supérieurs doivent créer avec ces derniers un cadre fonctionnel de concertation pour régler, dans le respect de la hiérarchie/préséance, tous les différends menaçant le vivre-ensemble et pour maintenir la paix puis la cohésion sociale au sein de la communauté ;
- les rois doivent être à l’écoute permanente des chefs supérieurs avec lesquels ils partagent le même espace socioculturel ;
- les chefs supérieurs partageant au moins un espace socioculturel avec un roi, se réfèrent à lui pour le règlement de tout différend ou toute autre action pour le maintien de la cohésion sociale et de la paix au sein de la communauté ;
- les chefs supérieurs partageant au moins un espace socioculturel avec un roi, reconnaissent son autorité morale et hiérarchique sur eux.
TITRE III
ORGANISATION – FONCTIONNEMENT DE LA CHEFFERIE TRADITIONNELLE
CHAPITRE PREMIER
ORGANISATION DE LA CHEFFERIE TRADITIONNELLE
Article 12 : La chefferie traditionnelle est organisée sur la base de règles coutumières historiquement admises et conformes aux lois et valeurs de la République. La chefferie traditionnelle est incarnée par un roi, un chef supérieur ou un chef coutumier. Le roi, le chef supérieur ou le chef coutumier est chargé de la mise en œuvre de la mission et des attributions dévolues à la chefferie traditionnelle. L’intronisation d’un roi ou l’installation d’un chef supérieur ou d’un chef coutumier est faite conformément aux règles coutumières de la chefferie traditionnelle concernée. L’intronisation d’un roi ou l’installation d’un chef supérieur ou d’un chef coutumier est constatée par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de l’intérieur. Cet arrêté vaut acte de reconnaissance de l’office du roi, du chef supérieur ou du chef coutumier. Il est désigné une structure en charge de l’appui et de l’accompagnement de la chefferie traditionnelle. La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de ladite structure sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de l’intérieur.
Article 13 : Il est créé un conseil de désignation dans chacune des chefferies traditionnelles énumérées aux articles 5, 6 et 7 de la présente loi. La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement des conseils de désignation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de l’intérieur sur proposition des structures en charge de l’appui et de l’accompagnement de la chefferie traditionnelle.
Article 14 : Les critères de dévolution du pouvoir traditionnel au niveau des seize royaumes énumérés dans l’article 5 de la présente loi se présentent comme suit :
14.1) Dans le royaume d’Allada, le candidat à la fonction royale :
- est désigné sous la conduite du conseil de désignation ;
- provient de l’une des lignées concernées par le trône de Kokpon ;
- est un prince ;
- est une personne apte à la fonction royale ;
- maîtrise les rouages et les pratiques de la tradition ;
- est validé par le(s) prêtre(s) de l’oracle désigné(s) par le conseil de désignation.
La succession au trône de Kokpon s’effectue de façon rotative entre les lignées : Awessou Dangbassa, Dako, Hounnougoungoun, Kpokonnou, Adoumadjogbado, Dètchaada, Midjo, Dèka, Ganhoua, Sindjè, Djigla, Djihinto, Kanfon, Bêdégla Toyi, Kpodégbé.
14.2) Dans le royaume de Danhomè, le candidat à la fonction royale :
- est désigné sous la conduite du conseil de désignation ;
- provient de l’une des lignées royales régnantes ;
- présente une intégrité physique et morale ;
- dispose des aptitudes à bien chanter, marcher ;
- est issu d’une mère d’origine roturière ou servile et non princière ;
- est validé par le(s) prêtre(s) de l’oracle désigné(s) par le conseil de désignation.
La succession au trône de Houégbadja s’effectue de façon alternative entre les lignées Béhanzin et Agoli-Agbo.
14.3) Dans le royaume de Dogbo-Ahomey, la fonction royale est assumée simultanément par un roi et une reine. Le candidat roi :
- est désigné sous la conduite du conseil de désignation ;
- provient de l’une des lignées régnantes ;
- jouit d’une intégrité physique et morale ;
- est une personne de troisième âge ;
- est un non-jumeau ou non-géniteur de jumeaux ;
- est validé par le(s) prêtre(s) de l’oracle désigné(s) par le conseil de désignation.
La candidate reine :
- est désignée sous la conduite du conseil de désignation ;
- est une princesse de Bamè ;
- est physiquement et moralement intègre ;
- est en état de ménopause.
La succession à la fonction royale dans le royaume de Dogbo-Ahomey s’effectue au sein des neuf lignées suivantes se trouvant à Bamè : Assouihon, Holougbégnon, Edoh, Tossouvignon, Togan, Eko, Tétévi, Djéwlé, Noumadji.
14.4) Dans le royaume de Hogbonou, le candidat à la fonction royale :
- est désigné sous la conduite du conseil de désignation ;
- provient de l’une des huit branches princières issues de Tê-Agbanlin ;
- est apte et en bonne forme physique ;
- connaît les pratiques et usages de la tradition ;
- est validé par le(s) prêtre(s) de l’oracle désigné(s) par le conseil de désignation.
La succession au trône de Tè-Agbanalin s’effectue de façon rotative entre les branches princières suivantes : Dè Hiakpon, Dè Lokpon, Dè Houdé, Dè Messè, Dè Houyi, Tè Adah, Tè Vossou et Tè Wokou.
14.5) Dans le royaume de Savalou, le candidat à la fonction royale :
- est désigné sous la conduite du conseil de désignation ;
- est issu de la succession au trône de Gbaguidi ;
- jouit d’une intégrité physique, mentale et psychique ;
- assure la régularité du paiement de ses cotisations destinées aux cérémonies funéraires ;
- est orphelin de père et de mère ;
- est validé par le(s) prêtre(s) de l’oracle désigné(s) par le conseil de désignation.
La succession au trône de Gbaguidi s’effectue de façon rotative entre les quatre lignées à savoir : Gougnisso, Lintonon, Zoudégla et Dada Vodoun.
14.6) Dans le royaume de Igbo-Idaasha (Dassa-Zounmè), le candidat à la fonction royale :
- est désigné sous la conduite du conseil de désignation ;
- est issu de l’une des deux dynasties royales régnantes ;
- jouit d’une intégrité physique et morale ;
- est orphelin de père et de mère ;
- est validé par le(s) prêtre(s) de l’oracle désigné(s) par le conseil de désignation.
La succession s’effectue de façon rotative entre la dynastie royale des Odjo et celle des Djagoun Oyimbo. La dynastie des Odjo fournit de façon continue deux rois au trône avant que celle Djagoun Oyimbo n’en fournisse un.
14.7) Dans le royaume de Kétou, le candidat à la fonction royale :
- est désigné sous la conduite du conseil de désignation ;
- est issu de l’une des dynasties régnantes ;
- est orphelin de père et de mère ;
- est validé par le(s) prêtre(s) de l’oracle désigné(s) par le conseil de désignation.
La succession s’effectue de façon rotative entre les dynasties : Aro, Mecha, Mêfou, Alapini et Magbo.
14.8) Dans le royaume de Itakété (Sakété), le candidat à la fonction royale :
- est désigné sous la conduite du conseil de désignation ;
- est issu de l’une des deux grandes dynasties qui fournissent des candidats au trône du royaume de façon alternative ;
- est validé par le(s) prêtre(s) de l’oracle désigné(s) par le conseil de désignation.
La succession dans le royaume de Itakété (Sakété) s’effectue de façon alternative entre les dynasties Agbadebo llou Eyibo et Agounloye Bi Eyibo.
14.9) Dans le royaume de Tchabè (Savè), le candidat à la fonction royale :
- est désigné sous la conduite du conseil de désignation ;
- est issu de l’une des deux dynasties qui se succèdent au trône du royaume de façon alternative ;
- est validé par le(s) prêtre(s) de l’oracle désigné(s) par le conseil de désignation.
Dans le royaume de Tchabè (Savè), la succession s’effectue de façon alternative entre la dynastie des Ifa et celle des Akikindjou.
14.10) Dans le royaume de Nikki, le candidat à la fonction royale :
- est désigné sous la conduite du conseil de désignation ;
- est choisi au sein des quatre dynasties régnantes actuelles ;
- est orphelin de père et de mère ;
- a atteint l’âge de maturité ;
- est apte et jouit de son intégrité physique.
Dans le royaume de Nikki, la succession au trône s’effectue entre les quatre dynasties régnantes que sont : Mako Gbassi, Sesi Makararou, Mako Korarou et Sannou Yari Lafiarou.
14.11) Dans le royaume de Boué, le processus de désignation du roi est identique à celui de Nikki. Toutefois, c’est seulement la dynastie des Tosu qui organise la succession au trône. Cette succession intervient par génération, dans le strict respect du principe de la primogéniture à l’intérieur des générations.
14.12) Dans le royaume de Kika, le processus de désignation du roi est identique à celui de Nikki. Toutefois, les Buenre constituent la seule dynastie qui fournit des rois au trône de Kika.
14.13) Dans le royaume de Sandiro, le processus de désignation du roi est identique à celui de Nikki. Toutefois, c’est seulement la dynastie des Moro qui est habilitée à fournir des candidats au trône.
14.14) Dans le royaume de Kpanné (Kouandé), le processus de désignation du roi est identique à celui de Nikki. Toutefois, les Makararou constituent la seule dynastie qui anime la vie politique traditionnelle dans le royaume et fournit les candidats au trône.
14.15) Dans le royaume de Kilir ou Djougou, le candidat à la fonction royale :
- est désigné sous la conduite du conseil de désignation ;
- est issu de l’une des trois dynasties régnantes ;
- présente des signes de sagesse, d’intégrité physique et morale ;
- est validé par le(s) prêtre(s) de l’oracle désigné(s) par le conseil de désignation.
Dans le royaume de Kilir ou Djougou, la succession au trône s’effectue de façon alternative entre les Kpétoni, Atakora et Gnonra.
14.16) Dans le royaume de Bassila, le candidat à la fonction royale :
- est désigné sous la conduite du conseil de désignation ;
- provient de l’une des trois dynasties régnantes ;
- incarne les valeurs d’intégrité physique et morale, de vérité, de patience et de sagesse ;
- est validé par le(s) prêtre(s) de l’oracle désigné(s) par le conseil de désignation.
Dans le royaume de Bassila, la succession s’effectue de façon rotative entre les dynasties : Affo, Tchabi et Allè.
Article 15 : Les critères de dévolution du pouvoir traditionnel au niveau des chefferies traditionnelles énumérées dans les articles 5, 6 et 7 de la présente loi sont répertoriés et mis à la disposition des conseils de désignation par la commission nationale permanente de suivi de la chefferie traditionnelle.
Article 16 : Tout citoyen qui remplit les conditions héritées de la tradition, peut être choisi comme roi, chef supérieur ou chef coutumier.
Article 17 : Nul ne peut exercer les fonctions de roi, de chef supérieur ou de chef coutumier s’il a fait l’objet d’une condamnation par décision judiciaire devenue définitive à une peine afflictive ou infamante, s’il ne jouit de ses droits civiques et politiques ou s’il y a incompatibilité. Le roi, le chef supérieur ou le chef coutumier ne peut être membre d’aucun parti politique.
Article 18 : Chaque chefferie traditionnelle porte la dénomination consacrée par la tradition. Le roi, le chef supérieur ou le chef coutumier porte le titre qui lui est conféré par la tradition, les us et coutumes. Nul ne peut se prévaloir du titre de roi, de chef supérieur ou de chef coutumier s’il n’est choisi comme tel, sous peine des sanctions pénales relatives à l’usurpation de titre.
Article 19 : Le roi est assisté d’un conseil de trône ayant des connaissances avérées des us et coutumes de la communauté. Les membres du conseil de trône sont désignés par le roi suivant les règles coutumières du royaume. Le chef supérieur ou le chef coutumier est assisté d’un conseil de sages ayant des connaissances avérées des us et coutumes de la communauté ou du groupe sociolinguistique. Les membres du conseil de sages sont désignés suivant les règles coutumières de la communauté ou du groupe socioculturel concerné.
Article 20 : Chacune des chefferies traditionnelles indiquées aux articles 5, 6 et 7 de la présente loi est représentée par son roi, son chef supérieur ou son chef coutumier qui siège à vie à la chambre nationale de la chefferie traditionnelle.
Article 21 : Les chefferies traditionnelles reconnues aux articles 5, 6 et 7 de la présente loi sont représentées au sein de la chambre nationale de la chefferie traditionnelle suivant leurs organisations respectives. Les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la chambre nationale de la chefferie traditionnelle sont fixés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition conjointe des ministres chargés de la culture, de l’intérieur et de la justice.
Article 22 : Il est créé une commission nationale permanente chargée du suivi de la chefferie traditionnelle. Les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale permanente chargée du suivi de la chefferie traditionnelle sont fixés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition conjointe des ministres chargés de la culture, de l’intérieur et de la justice.
CHAPITRE II
FONCTIONNEMENT DE LA CHEFFERIE TRADITIONNELLE
Article 23 : Les membres du conseil de trône ou du conseil de sages sont dûment convoqués par le roi, le chef supérieur ou le chef coutumier suivant les règles coutumières de la chefferie traditionnelle concernée.
Article 24 : Les décisions des rois, des chefs supérieurs et coutumiers sont prises suivant les règles coutumières de la chefferie traditionnelle concernée.
Article 25 : En cas de vacance à la tête d’une chefferie traditionnelle, le conseil de trône ou le conseil de sages en informe l’autorité compétente dans un délai de quinze jours au plus à compter du jour de la survenance de la vacance.
Article 26 : Tout pouvoir traditionnel s’exerce conformément aux règles héritées de la tradition et sans entrave aux valeurs républicaines.
Article 27 : Le roi et les membres du conseil de trône, le chef supérieur ou le chef coutumier et les membres de son conseil de sages sont personnellement responsables des infractions aux lois et règlements commis dans l’exercice de leurs fonctions.
TITRE IV
PRINCIPES ET AVANTAGES LIÉS À LA FONCTION DE ROI, DE CHEF SUPÉRIEUR ET DE CHEF COUTUMIER
CHAPITRE PREMIER
PRINCIPES LIÉS À LA FONCTION DE ROI, DE CHEF SUPÉRIEUR ET DE CHEF COUTUMIER
Article 28 : Dans l’accomplissement de sa mission, le roi, le chef supérieur ou le chef coutumier a le devoir d’observer les principes de neutralité, d’impartialité, de réserve et de transparence. Il a l’obligation de se montrer digne et loyal envers l’État et sa communauté. Le roi, le chef supérieur ou le chef coutumier doit éviter toute forme de discrimination au sein de la communauté et avec les autres communautés afin de maintenir la paix et la cohésion sociales.
Article 29 : Le roi, le chef supérieur ou le chef coutumier porte dans les lieux publics et pour les cérémonies officielles, les tenues spécifiques dédiées à sa fonction. Les modalités de port desdites tenues seront précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de l’intérieur.
Article 30 : Le roi, le chef supérieur ou le chef coutumier doit respecter et faire respecter les attributs de la cour ou de son groupe socioculturel. Tout citoyen, quelle que soit son appartenance socioculturelle, lui doit le respect que commande les lois et règlements de la République à l’égard de ses concitoyens. Les membres de son espace socioculturel qui, explicitement ou implicitement, consentent à lui faire allégeance se soumettent à son autorité.
Article 31 : Le roi, le chef supérieur ou le chef coutumier est tenu de résider sur le territoire de la chefferie dont il a la charge. Toutefois, il jouit de la liberté d’aller et venir qui ne saurait entraver sa fonction de roi, de chef supérieur ou de chef coutumier.
CHAPITRE II
AVANTAGES LIÉS À LA FONCTION DE ROI, DE CHEF SUPÉRIEUR ET DE CHEF COUTUMIER
Article 32 : Le roi, le chef supérieur ou le chef coutumier est invité par les autorités politiques ou administratives à des manifestations officielles de la République. Il peut être nommé dans l’un des ordres nationaux.
Article 33 : L’État prend des mesures pour réhabiliter les palais royaux pour le roi ou contribuer à aménager un logement convenable pour le chef supérieur ou le chef coutumier. L’État peut accorder au roi, au chef supérieur et au chef coutumier ou à chaque chefferie traditionnelle, une allocation selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
Article 34 : L’État assure, conformément aux textes en vigueur, au roi, au chef supérieur et au chef coutumier la protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont il peut faire l’objet dans l’exercice de sa fonction.
Article 35 : Un roi, un chef supérieur ou un chef coutumier peut être consulté à titre ponctuel et confidentiel sur certaines questions de la République si l’autorité compétente le juge nécessaire. Toutefois, son avis est consultatif.
Article 36 : L’État reconnaît les dignitaires désignés dans chacune des chefferies traditionnelles prévues aux articles 5, 6 et 7 de la présente loi et leur accorde le traitement mérité lorsqu’ils représentent leur chefferie dans les missions de l’État.
Article 37 : Tous autres avantages ou traitements spécifiques au profit des rois, chefs supérieurs et chefs coutumiers sont fixés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition conjointe des ministres chargés de la culture et des finances.
TITRE V
CESSATION DES FONCTIONS DE ROI, DE CHEF SUPÉRIEUR OU DE CHEF COUTUMIER – SANCTIONS
CHAPITRE PREMIER
CESSATION DES FONCTIONS DE ROI, DE CHEF SUPÉRIEUR OU DE CHEF COUTUMIER
Article 38 : La cessation des fonctions d’un roi, d’un chef supérieur ou d’un chef coutumier, entraînant la vacance du siège, intervient par suite de décès, d’abdication, d’incapacité physique ou mentale permanente ou de condamnation définitive à une peine afflictive et infamante du titulaire ou par toute cause définie par la tradition et ne portant pas atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine.
Article 39 : La dévolution du pouvoir en cas de vacance à la tête d’une chefferie traditionnelle et la gestion de l’interrègne se font conformément aux règles coutumières de la chefferie traditionnelle concernée.
CHAPITRE II
SANCTIONS
Article 40 : Tout roi, chef supérieur ou chef coutumier menant des activités politiques et/ou partisanes ou ayant des manquements de nature à compromettre ses fonctions de roi, de chef supérieur ou de chef coutumier s’expose aux sanctions suivantes qui peuvent être prononcées à son encontre, en fonction de la gravité du manquement :
- l’avertissement ;
- la suspension ;
- le retrait de l’acte de reconnaissance.
Article 41 : L’avertissement est prononcé par l’autorité préfectorale compétente.
Article 42 : La suspension du roi, du chef supérieur ou du chef coutumier est prononcée par le ministre chargé de l’intérieur après consultation du ministre chargé de la culture, sur rapport motivé de l’autorité préfectorale. La suspension ne peut excéder six mois. Pendant la durée de la suspension, l’intérim du roi, du chef supérieur ou du chef coutumier est assuré conformément aux règles coutumières de la chefferie traditionnelle concernée.
Article 43 : En cas de manquements graves compromettant sa fonction ou violant les lois et règlements en vigueur en République du Bénin, le roi, le chef supérieur ou le chef coutumier s’expose au retrait de l’acte de reconnaissance. Il encourt la même sanction en cas de récidive pour les manquements déjà sanctionnés par une suspension. La décision de retrait de l’acte de reconnaissance du roi, du chef supérieur ou du chef coutumier est prise par le ministre chargé de l’intérieur après consultation du ministre chargé de la culture.
Article 44 : Le mis en cause est mis en mesure de fournir ses moyens de défense. Les décisions de suspension ou de retrait de l’acte de reconnaissance sont motivées et notifiées au roi, au chef supérieur ou au chef coutumier concerné.
Article 45 : En cas de retrait de l’acte de reconnaissance, le roi, le chef supérieur ou le chef coutumier perd tous ses attributs et les avantages y relatifs. Il en est de même en cas de condamnation pénale définitive avec emprisonnement du roi, du chef supérieur ou du chef coutumier.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES – FINALES
Article 46 : Les rois, chefs supérieurs ou chefs coutumiers qui sont membres d’un parti politique disposent d’un délai de trois mois à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi pour s’y conformer. Par ailleurs, le roi, le chef supérieur ou le chef coutumier qui assume un mandat électif national ou local à la date d’entrée en vigueur de la présente loi conserve son statut jusqu’à l’expiration de son mandat.
Article 47 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comme Loi de l’État.
Fait à Cotonou, le 03 avril 2025
Par le Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement,
Patrice TALON
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation,
Yvoh DETCHENOU
Le Ministre de la Culture,
Babalola Jean-Michel Hervé ABIMBOLA
Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique,
Alassane SEIDOU